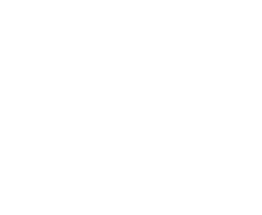La bible de l'écrivain : Le dialogue, l'ambiance et les effets sonores
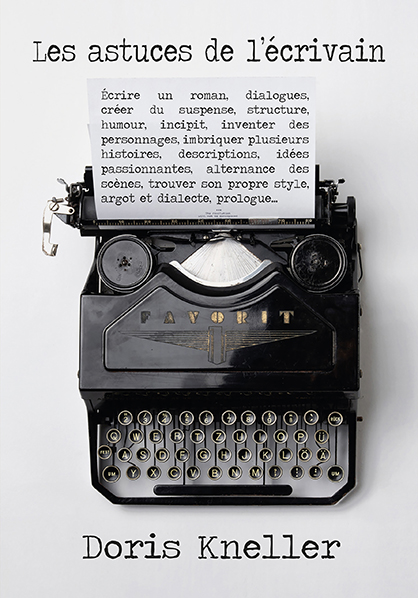
2023, 222 pages Disponible comme paperback chez Amazon, 14 €
et comme ebook, 5 € chez Amazon et Kobo (Fnac)
Extrait du 11ème chapitre
Le dialogue est sans doute le moyen le plus efficace pour insuffler la vie à notre roman. Le film qui se déroule devant les yeux de nos lecteurs ne demande pas seulement des images expressives, mais également du son.
... Les cinéastes ont donc commencé à travailler sur les effets sonores d'ambiance. Dès lors, les bruits de fond ont intentionnellement été incorporés dans les films, et des environnements sonores réalistes ont pu être créés.
Tout cela n'avait qu'un seul objectif : améliorer l'expérience auditive du public qui a vite appris à estimer les atmosphères réalistes constituées par le bruit des touches d'un clavier dans un bureau, le son de la cafetière dans un restaurant ou les voix du couple à la table voisine en train de se quereller. Progressivement, le son est devenu l'outil le plus apprécié pour produire des ambiances.
Cependant, en quoi cette découverte des cinéastes intéresse-t-elle les écrivains ? Il est vrai que les romanciers rédigent aussi une sorte de scénario de film... mais dans leur cas, il s'agit exclusivement du cinéma qui se déroule dans l'esprit du lecteur. Ce genre de film a-t-il également besoin d'effets sonores d'ambiance ?
Prenons une conversation du style :
— Où est-ce que tu cours comme ça ? demanda Pierre.
— Je cherche Robert, répondit Anne. Tu ne l'as pas vu quelque part ?
— Non, pas depuis hier.
— En fait, expliqua Anne, un policier veut qu'il se présente au poste.
— Au poste ? Il a certainement encore fait une bêtise.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Le sujet de ces quelques lignes est clair, il ne manque rien pour les comprendre, et les petites remarques du genre « demanda Pierre » ou « répondit Anne » renseigne le lecteur sur la personne qui parle.
Tout est là. Et pourtant, ce dialogue paraît vide. Ce qu'il lui manque pour prendre vie, c'est l'ambiance.
Nous pourrions l'améliorer en ajoutant quelques bruits provoqués par le comportement de nos personnages.
— Où est-ce que tu cours comme ça ? demanda Pierre.
Rapidement, il ferma la porte. Anne essaya d'atteindre la poignée, mais son mari la repoussa brutalement. Elle trébucha et heurta violemment la petite table avec le vase qui, miraculeusement, resta debout.
— Je cherche Robert, répondit-elle, hors d'haleine. Tu ne l'as pas vu quelque part ?
— Non, pas depuis hier.
L'homme secoua la tête.
— En fait, expliqua Anne, un policier veut qu'il se présente au poste.
Elle tenta de retrouver son équilibre, mais chancela de nouveau. Cette fois-ci, la vase tomba et s'écrasa par terre.
— Au poste ? Furieux, il frappa du pied, avant de grogner : Il a certainement encore fait une bêtise.
Immédiatement, Anne éclata en sanglots.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Dans cette version, le dialogue n'a pas changé d'un seul mot. Mais une petite conversation apparemment tranquille s'est transformée en une dispute bruyante.
Le maître-mot est « ambiance ».
Analysons ce qui a été modifié. La phrase initiale est identique dans les deux extraits. Le lecteur ignore encore, si les personnages vont communiquer en amis ou en ennemis. Du texte précédant notre petit échange (que nous n'avons pas produit ici), il sait probablement déjà qu'Anne et Pierre sont mariés. Mais pour le moment, il ne peut pas deviner comment va se passer leur rencontre actuelle. Tout est donc possible.
Pourtant, déjà dans la phrase suivante, nous entendons du bruit : Pierre ferme « rapidement » la porte, et le lecteur se doute qu'une fermeture rapide est toujours associée à une sorte de « boum ». Le son dans son film intérieur est donc activé.
Puis, la scène devient de plus en plus bruyante. Anne, repoussée par son mari, trébuche et heurte violemment une table. Quelques phrases plus tard, le vase posé sur cette table s'écrase par terre. C'est peut-être le moment où le lecteur a envie de baisser le son de son film. De toute manière, il y a beaucoup de vacarme.
Par la suite, la scène se calme un peu. Le mari frappe du pied par terre, mais il ne crie pas : il grogne. Anne éclate en sanglots.
Le son prend alors la forme d'une sorte de courbe. L'échange commence calmement. Ensuite, le son monte jusqu'à devenir presque insupportable lorsque la table se renverse et la vase s'éclate. Le coup du pied du mari le fait baisser un peu jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec un grognement et des sanglots.
Pendant tout ce temps, le dialogue continue. Cependant, contrairement à la première version, il se déroule ici dans une ambiance évoquant la querelle ou même la haine.
Et tout cela juste avec des sons décrits dans le texte et intégrés dans le « film » du lecteur.
Nous pourrions évidemment partir du principe que le dialogue constitue la base idéale pour une scène d'hostilité. Mais le contraire est tout aussi possible.
— Où est-ce que tu cours comme ça ? demanda Pierre.
D'un geste rapide, il rattrapa Anne qui avait failli tomber. Juste au moment où elle s'était apprêtée à sortir, il avait poussé la porte de l'extérieur qui avait bousculé sa femme.
Tout cela n'avait qu'un seul objectif : améliorer l'expérience auditive du public qui a vite appris à estimer les atmosphères réalistes constituées par le bruit des touches d'un clavier dans un bureau, le son de la cafetière dans un restaurant ou les voix du couple à la table voisine en train de se quereller. Progressivement, le son est devenu l'outil le plus apprécié pour produire des ambiances.
— Je cherche Robert, répondit Anne. Tu ne l'as pas vu quelque part ?
— Non, pas depuis hier.
— En fait, expliqua Anne, un policier veut qu'il se présente au poste.
— Au poste ? Il a certainement encore fait une bêtise.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Tout est là. Et pourtant, ce dialogue paraît vide. Ce qu'il lui manque pour prendre vie, c'est l'ambiance.
Nous pourrions l'améliorer en ajoutant quelques bruits provoqués par le comportement de nos personnages.
Rapidement, il ferma la porte. Anne essaya d'atteindre la poignée, mais son mari la repoussa brutalement. Elle trébucha et heurta violemment la petite table avec le vase qui, miraculeusement, resta debout.
— Je cherche Robert, répondit-elle, hors d'haleine. Tu ne l'as pas vu quelque part ?
— Non, pas depuis hier.
L'homme secoua la tête.
— En fait, expliqua Anne, un policier veut qu'il se présente au poste.
Elle tenta de retrouver son équilibre, mais chancela de nouveau. Cette fois-ci, la vase tomba et s'écrasa par terre.
— Au poste ? Furieux, il frappa du pied, avant de grogner : Il a certainement encore fait une bêtise.
Immédiatement, Anne éclata en sanglots.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Le maître-mot est « ambiance ».
Analysons ce qui a été modifié. La phrase initiale est identique dans les deux extraits. Le lecteur ignore encore, si les personnages vont communiquer en amis ou en ennemis. Du texte précédant notre petit échange (que nous n'avons pas produit ici), il sait probablement déjà qu'Anne et Pierre sont mariés. Mais pour le moment, il ne peut pas deviner comment va se passer leur rencontre actuelle. Tout est donc possible.
Pourtant, déjà dans la phrase suivante, nous entendons du bruit : Pierre ferme « rapidement » la porte, et le lecteur se doute qu'une fermeture rapide est toujours associée à une sorte de « boum ». Le son dans son film intérieur est donc activé.
Puis, la scène devient de plus en plus bruyante. Anne, repoussée par son mari, trébuche et heurte violemment une table. Quelques phrases plus tard, le vase posé sur cette table s'écrase par terre. C'est peut-être le moment où le lecteur a envie de baisser le son de son film. De toute manière, il y a beaucoup de vacarme.
Par la suite, la scène se calme un peu. Le mari frappe du pied par terre, mais il ne crie pas : il grogne. Anne éclate en sanglots.
Le son prend alors la forme d'une sorte de courbe. L'échange commence calmement. Ensuite, le son monte jusqu'à devenir presque insupportable lorsque la table se renverse et la vase s'éclate. Le coup du pied du mari le fait baisser un peu jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec un grognement et des sanglots.
Pendant tout ce temps, le dialogue continue. Cependant, contrairement à la première version, il se déroule ici dans une ambiance évoquant la querelle ou même la haine.
Et tout cela juste avec des sons décrits dans le texte et intégrés dans le « film » du lecteur.
Nous pourrions évidemment partir du principe que le dialogue constitue la base idéale pour une scène d'hostilité. Mais le contraire est tout aussi possible.
D'un geste rapide, il rattrapa Anne qui avait failli tomber. Juste au moment où elle s'était apprêtée à sortir, il avait poussé la porte de l'extérieur qui avait bousculé sa femme.
— Je cherche Robert, répondit-elle, hors d'haleine. Tu ne l'as pas vu quelque part ?
Pierre lui caressa la tête pour la calmer.
— Non, pas depuis hier, fit-il d'une voix tranquille.
Anne se blottit dans ses bras et se mit à sangloter. Devant la fenêtre, une mésange entonna sa chanson de printemps.
— En fait, hoqueta-t-elle, un policier veut qu'il se présente au poste.
Doucement, Pierre ferma la porte qui était restée ouverte, amena sa femme au salon et ensemble, ils s'affalèrent sur le sofa. Le meuble gémit légèrement sous leur poids. L'oiseau s'était tu.
— Au poste ? Il a certainement encore fait une bêtise.
Anne pouvait sentir qu'il était alarmé. Bien que sa voix soit toujours calme, elle remarqua qu'il grinçait légèrement des dents. Cela signifie qu'il se fait du souci lui aussi, se dit-elle. Cette pensée la fit pleurer encore plus fort.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Bien que, de nouveau, le dialogue soit exactement le même, l'ambiance a complètement changé. Mais comme la version précédente, celle-ci est également régie par des bruits qui ne sont pas directement liés à la conversation.
Cette fois, la courbe de son reste à un niveau inférieur. Pierre rattrape Anne, ce qui provoque un léger bruit comme le grattage des pieds sur le sol ou le crépitement du tissu de leurs vêtements lorsque le corps de la femme glisse dans les bras de l'homme. Par sa respiration, le lecteur « entend » qu'elle est hors haleine. Ensuite, elle se met à sangloter. Parallèlement, un oiseau commence à chanter. C'est le pic de notre courbe, bien qu'il ne soit pas très élevé. Le son baisse quand elle se met à hoqueter et lui à grincer les dents. Quant à la mésange, elle se tait juste au moment où le sofa gémit. En revanche, le bruit augmente à la fin, lorsque Anne pleure plus fort — et avec lui le suspense.
Nous pouvons comparer ces courbes de son à la musique très prégnante dans les polars télévisés des années 1980. À cette époque, il était à la mode d'augmenter le son dès que l'action devenait plus captivante.
Ainsi, nous nous rendons compte que le romancier dispose pratiquement des mêmes moyens qu'un cinéaste. Comme lui, il ne doit pas se contenter d'aligner actions et conversations : lui aussi peut créer des ambiances en manipulant le son.
Analysons un dernier exemple. Cette fois-ci, nous aurons recours à une œuvre classique : Le maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov, dans une traduction de Claude Ligny.
— Des dollars dans la bouche d'aération..., dit pensivement le premier citoyen.
Puis il demanda à Nicanor Ivanovitch, d'un air doux et poli :
— C'est à vous ce petit paquet ?
— Non ! cria Nicanor d'une voix terrible. C'est... ce sont des ennemis qui l'ont caché là !
— ça se peut, dit le premier, qui ajouta, toujours avec douceur : Bon, maintenant, il faut nous donner le reste.
— Mais j'ai rien ! Rien, je le jure devant Dieu, et j'ai jamais eu ça entre les mains ! cria le gérant avec désespoir.
Il se rua vers une commode, ouvrit un tiroir à grand bruit, et en sortit sa serviette, tout en poussant des exclamations sans suite.
Dans ce texte, le son ne se présente pas sous la forme d'une courbe, mais plutôt comme une vague qui monte et descend plusieurs fois. Le dialogue commence presque en silence « dit pensivement », « d'un air doux » — deux expressions qui n'évoquent pas l'idée d'un bruit très fort.
Mais tout de suite, l'ambiance change : « cria... d'une voix terrible ». La conversation bascule donc d'un « air doux » vers une « voix terrible ». Le pic qui, dans nos autres exemples, n'était atteint qu'après plusieurs lignes de dialogue se produit immédiatement — pour être délaissé dès la prochaine ligne. Le son retombe dans les registres doux : « ajouta, toujours avec douceur »...
...et de nouveau, notre ligne d'ambiance monte à l'extrême : « cria le gérant », « ouvrit un tiroir à grand bruit », « en poussant des exclamations ».
Nous l'avons compris. Dans ce dialogue, le niveau sonore change avec le personnage qui parle : il sert donc à caractériser les différents protagonistes. Chacun tisse autour de lui sa propre ambiance — non seulement avec les mots qu'il prononce, mais aussi avec son volume de voix.
L'emploi de cette technique s'impose par exemple lors d'une situation, dans laquelle l'auteur veut éviter la description de ses personnages. Sous l'effet du niveau sonore des voix, leur image se crée spontanément devant les yeux du lecteur : l'image qui, pour lui, représente le genre de personnage qui correspond aux voix qu'il « entend ».
Tu remarqueras que, dans ce dialogue, Boulgakov a sciemment renoncé aux effets de fond, avec la seule exception du tiroir qui s'ouvre « à grand bruit ». Ce qui compte dans ces lignes, c'est juste le niveau sonore des voix qui, par leur manière de s'exprimer, confère un caractère aux personnages.
Mais l'auteur aurait évidemment pu aussi travailler avec des bruits de fond pour modifier l'ambiance de la scène et le caractère des personnages. Imaginons un exemple : ...
Pierre lui caressa la tête pour la calmer.
— Non, pas depuis hier, fit-il d'une voix tranquille.
Anne se blottit dans ses bras et se mit à sangloter. Devant la fenêtre, une mésange entonna sa chanson de printemps.
— En fait, hoqueta-t-elle, un policier veut qu'il se présente au poste.
Doucement, Pierre ferma la porte qui était restée ouverte, amena sa femme au salon et ensemble, ils s'affalèrent sur le sofa. Le meuble gémit légèrement sous leur poids. L'oiseau s'était tu.
— Au poste ? Il a certainement encore fait une bêtise.
Anne pouvait sentir qu'il était alarmé. Bien que sa voix soit toujours calme, elle remarqua qu'il grinçait légèrement des dents. Cela signifie qu'il se fait du souci lui aussi, se dit-elle. Cette pensée la fit pleurer encore plus fort.
— Non. Robert ne fait plus de bêtises. Il l'a promis.
Cette fois, la courbe de son reste à un niveau inférieur. Pierre rattrape Anne, ce qui provoque un léger bruit comme le grattage des pieds sur le sol ou le crépitement du tissu de leurs vêtements lorsque le corps de la femme glisse dans les bras de l'homme. Par sa respiration, le lecteur « entend » qu'elle est hors haleine. Ensuite, elle se met à sangloter. Parallèlement, un oiseau commence à chanter. C'est le pic de notre courbe, bien qu'il ne soit pas très élevé. Le son baisse quand elle se met à hoqueter et lui à grincer les dents. Quant à la mésange, elle se tait juste au moment où le sofa gémit. En revanche, le bruit augmente à la fin, lorsque Anne pleure plus fort — et avec lui le suspense.
Nous pouvons comparer ces courbes de son à la musique très prégnante dans les polars télévisés des années 1980. À cette époque, il était à la mode d'augmenter le son dès que l'action devenait plus captivante.
Puis il demanda à Nicanor Ivanovitch, d'un air doux et poli :
— C'est à vous ce petit paquet ?
— Non ! cria Nicanor d'une voix terrible. C'est... ce sont des ennemis qui l'ont caché là !
— ça se peut, dit le premier, qui ajouta, toujours avec douceur : Bon, maintenant, il faut nous donner le reste.
— Mais j'ai rien ! Rien, je le jure devant Dieu, et j'ai jamais eu ça entre les mains ! cria le gérant avec désespoir.
Il se rua vers une commode, ouvrit un tiroir à grand bruit, et en sortit sa serviette, tout en poussant des exclamations sans suite.
Mais tout de suite, l'ambiance change : « cria... d'une voix terrible ». La conversation bascule donc d'un « air doux » vers une « voix terrible ». Le pic qui, dans nos autres exemples, n'était atteint qu'après plusieurs lignes de dialogue se produit immédiatement — pour être délaissé dès la prochaine ligne. Le son retombe dans les registres doux : « ajouta, toujours avec douceur »...
...et de nouveau, notre ligne d'ambiance monte à l'extrême : « cria le gérant », « ouvrit un tiroir à grand bruit », « en poussant des exclamations ».
Nous l'avons compris. Dans ce dialogue, le niveau sonore change avec le personnage qui parle : il sert donc à caractériser les différents protagonistes. Chacun tisse autour de lui sa propre ambiance — non seulement avec les mots qu'il prononce, mais aussi avec son volume de voix.
L'emploi de cette technique s'impose par exemple lors d'une situation, dans laquelle l'auteur veut éviter la description de ses personnages. Sous l'effet du niveau sonore des voix, leur image se crée spontanément devant les yeux du lecteur : l'image qui, pour lui, représente le genre de personnage qui correspond aux voix qu'il « entend ».